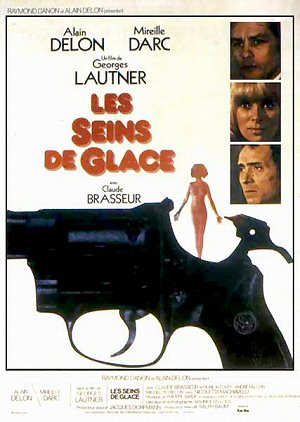 En 1972, la firme Lira Films engage Jean-Pierre
Mocky pour adapter le roman de Richard Matheson,
Les Seins de Glace. "Comme j'étais très
copain avec Polanski, raconte le réalisateur,
je pensais prendre son interprète de Rosemary's baby,
Mia Farrow, qui me paraissait être
le personnage des Seins de glace. Autour de cette femme fragile qui tue
avec un pic à glace tout homme qui s'approche d'elle, parce qu'elle a
été traumatisée dans sa jeunesse, j'avais Alain
Delon et Jon Finch, qui venait
de jouer dans Frenzy d'Hitchcock. "
Delon dirigé par Mockyâ¦
ce mariage inattendu est annoncé comme tel dans les médias mais
ne se fait finalement pas. "Brusquement, un jour, alors que je m'occupais
de la mise en place des décors avec le directeur de production, aux studios
de la Victorine à Nice, quatre semaines avant le début du tournage,
je reçois un coup de téléphone de Delon
qui me dit : "Ecoute, j'ai bien réfléchi : c'est
Mireille Darc et Michel
Duchaussoy." Ce à quoi je réponds : "Alain,
j'aime beaucoup Mireille Darc, mais je ne la vois
pas dans le rôle." Il me rétorque : "C'est ça
ou rien." Et il raccroche."
En 1972, la firme Lira Films engage Jean-Pierre
Mocky pour adapter le roman de Richard Matheson,
Les Seins de Glace. "Comme j'étais très
copain avec Polanski, raconte le réalisateur,
je pensais prendre son interprète de Rosemary's baby,
Mia Farrow, qui me paraissait être
le personnage des Seins de glace. Autour de cette femme fragile qui tue
avec un pic à glace tout homme qui s'approche d'elle, parce qu'elle a
été traumatisée dans sa jeunesse, j'avais Alain
Delon et Jon Finch, qui venait
de jouer dans Frenzy d'Hitchcock. "
Delon dirigé par Mockyâ¦
ce mariage inattendu est annoncé comme tel dans les médias mais
ne se fait finalement pas. "Brusquement, un jour, alors que je m'occupais
de la mise en place des décors avec le directeur de production, aux studios
de la Victorine à Nice, quatre semaines avant le début du tournage,
je reçois un coup de téléphone de Delon
qui me dit : "Ecoute, j'ai bien réfléchi : c'est
Mireille Darc et Michel
Duchaussoy." Ce à quoi je réponds : "Alain,
j'aime beaucoup Mireille Darc, mais je ne la vois
pas dans le rôle." Il me rétorque : "C'est ça
ou rien." Et il raccroche."
L'affaire traîne en longueur. Alain Delon part
tourner Les Granges Brûlées de Jean Chapot avec Simone
Signoret et Mocky pense un temps interpréter
lui-même le rôle de Delon, face à
Jane Birkin (Mia Farrow n'étant
plus disponible). Mais la star s'entête et rachète les droits du
projet au réalisateur, qui financera ainsi Un linceul n'a pas de
poches et L'Ibis Rouge. Delon
tient à ce que Mireille Darc, qui est alors
sa compagne, obtienne le rôle car il considère qu'on l'a cantonnée
jusqu'ici aux rôles comiques et que son potentiel dramatique mériterait
d'être exploité. Pour son partenaire, il contacte finalement Claude
Brasseur. "Un jour, Delon
me fait venir d'urgence : "Voilà un scénario. Installe-toi,
lis. Après, je t'explique." C'était Les Seins de glace.
Il y avait deux rôles masculins dont un, d'avocat, prévu pour durer
trois semaines sur douze de tournage. "Alors ? â Je suis un peu jeune
pour l'avocat. â L'avocat, c'est moi. Je te propose le rôle principal.
Je veux faire ce film pour Mireille et toi. Mais vous n'êtes pas assez
connus pour que je le monte financièrement sur vous deux. Ce sera avec
nous trois ou pas du tout. Je suis propriétaire des droits.""
Pour Brasseur, qui est alors au creux de la vague,
c'est une véritable aubaine.
 Mireille Darc propose que Georges
Lautner réalise le film. Celui qui l'a dirigée dans Ne
nous fâchons pas ou La Grande Sauterelle n'est pourtant pas
un choix évident. "Il a hésité longtemps. Il est
à l'aise dans la comédie, il connaît toutes les ficelles
du rire, mais le drame n'est pas son terrain préféré. Il
savait pourtant que je lui en voulais de m'avoir complètement enlisée
dans ces rôles d'adorables femmes fatales. Et que je lui en aurais voulu
plus encore de ne pas prendre ce risque pour moi." Il accepte finalement
de relever le défi, pour Mireille Darc mais
aussi pour Alain Delon avec qui il n'a encore jamais
travaillé. "En une nuit, j'ai lu le roman et, le lendemain, j'ai
commencé l'adaptation et les dialogues. L'histoire a été
transposée : au lieu de Chicago, j'ai choisi la Côte d'Azur
comme décor. En même temps a été éliminé
du roman tout le côté conventionnel : au lieu de nous promener
parmi les truands, nous nous promènerons parmi d'honnêtes gens.
Mais il va sans dire que nous avons conservé le suspense et l'atmosphère
inquiétante de cette histoire à la Hitchcock."
L'adaptation est écrite par Lautner et son
beau-frère Albert Kantoff, "et avec des gens qui ont touché
de l'argent, mais qui ont préféré ne pas figurer au générique".
Mireille Darc propose que Georges
Lautner réalise le film. Celui qui l'a dirigée dans Ne
nous fâchons pas ou La Grande Sauterelle n'est pourtant pas
un choix évident. "Il a hésité longtemps. Il est
à l'aise dans la comédie, il connaît toutes les ficelles
du rire, mais le drame n'est pas son terrain préféré. Il
savait pourtant que je lui en voulais de m'avoir complètement enlisée
dans ces rôles d'adorables femmes fatales. Et que je lui en aurais voulu
plus encore de ne pas prendre ce risque pour moi." Il accepte finalement
de relever le défi, pour Mireille Darc mais
aussi pour Alain Delon avec qui il n'a encore jamais
travaillé. "En une nuit, j'ai lu le roman et, le lendemain, j'ai
commencé l'adaptation et les dialogues. L'histoire a été
transposée : au lieu de Chicago, j'ai choisi la Côte d'Azur
comme décor. En même temps a été éliminé
du roman tout le côté conventionnel : au lieu de nous promener
parmi les truands, nous nous promènerons parmi d'honnêtes gens.
Mais il va sans dire que nous avons conservé le suspense et l'atmosphère
inquiétante de cette histoire à la Hitchcock."
L'adaptation est écrite par Lautner et son
beau-frère Albert Kantoff, "et avec des gens qui ont touché
de l'argent, mais qui ont préféré ne pas figurer au générique".
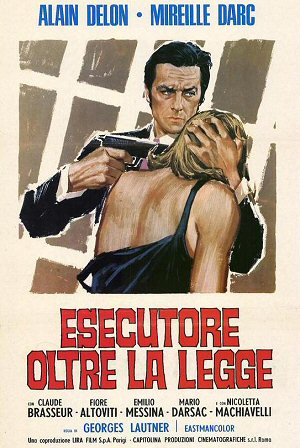 En réalisant un film voulu et produit par Alain
Delon, Lautner se retrouve avec des moyens
et des méthodes auxquels il n'est pas habitué. "Delon
voulait qu'on fasse un dîner et que toutes les filles soient en robe
du soir haute couture et que tous les bijoux soient vrais. Le plateau état
encombré de flics envoyés par Cartier pour surveiller leurs trucs.
J'ai été pris par l'ampleur. Ce n'était pas ma méthode
de travail, j'étais pris par les trucs qu'il fallait montrer, alors qu'on
doit s'en foutre. Je tournais beaucoup en plans largesâ¦"
En réalisant un film voulu et produit par Alain
Delon, Lautner se retrouve avec des moyens
et des méthodes auxquels il n'est pas habitué. "Delon
voulait qu'on fasse un dîner et que toutes les filles soient en robe
du soir haute couture et que tous les bijoux soient vrais. Le plateau état
encombré de flics envoyés par Cartier pour surveiller leurs trucs.
J'ai été pris par l'ampleur. Ce n'était pas ma méthode
de travail, j'étais pris par les trucs qu'il fallait montrer, alors qu'on
doit s'en foutre. Je tournais beaucoup en plans largesâ¦"
Pour le rôle de l'avocat, protecteur de la jeune femme qu'il sait psychologiquement
fragile, la star n'est disponible que deux semaines car Jacques
Deray l'attend à Marseille pour Borsalino &
Co. Lautner doit donc régler son
plan de travail en fonction de cela⦠et d'autres choses. " Delon
était entouré de tout un folklore assez curieux : des
gardes du corps, etc. On entendait encore les échos de l'affaire Markovicâ¦
Ce n'était pas de tout repos. Le premier jour, pour éviter qu'il
attende, au lieu de le faire venir et de lui dire : "Il y a tout à
régler, on tourne dans 1h15", j'avais réglé le plan
à l'avance. J'avais fait installer un travelling devant la maison où
l'on tournait. Quand il est arrivé, je n'étais pas làâ¦
Il était en voiture avec ses gardes du corps et il a exigé qu'on
casse le travelling. Il voulait descendre de sa voiture six mètres plus
loin, devant les marches de la maison. Les machinos ont cassé le travelling.
Ils l'ont remonté ensuite, après le départ de la voiture.
C'était un climat assez spécialâ¦"
À sa sortie, le film est conspué par les aficionados de Richard
Matheson mais rencontre le succès, permettant à Claude
Brasseur de relancer sa carrière et à Mireille
Darc de modifier son image. Fort de ce "test", Georges
Lautner sera engagé en 1977 par Alain Delon
pour réaliser Mort d'un pourri.
Philippe Lombard